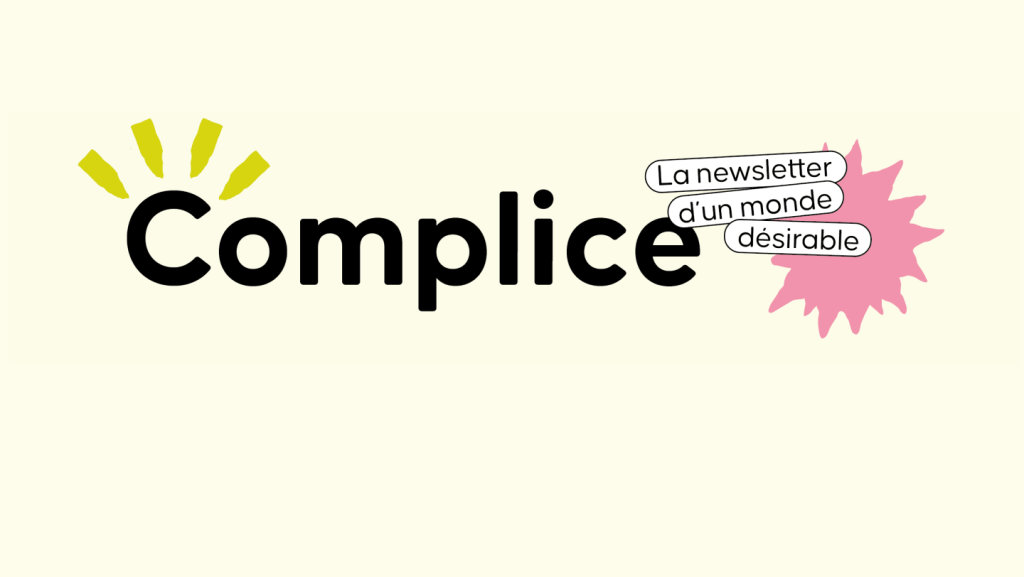#dossier-special
Comment résister au backlash ?
Depuis quelques mois, un retour de bâton conservateur s’installe. Discret d’abord, brutal désormais. Il grignote, attaque, détricote des années de progrès sur le climat, la diversité, l’inclusion, la liberté…
Face à cette offensive, une question émerge avec urgence : comment résister ?
Pour cette 3ᵉ newsletter, nous avons choisi de mettre en lumière celles et ceux qui tiennent bon. Celles et ceux qui refusent de plier face au cynisme, à la peur ou au renoncement. Qui défendent la vérité scientifique, l’égalité, l’écologie, la souveraineté même lorsque ces valeurs sont attaquées.
Au sommaire de notre dossier spécial :
👉 Résister à Trump : “Don’t believe him !”
👉 Aux États-Unis, la science entre en résistance
👉 L’union sacrée des Canadiens face à Trump
👉 Face au backlash conservateur : les entreprises entre rétropédalage et résistance
👉 Sous pression, l’ADEME choisit la transparence et l’action.
👉 Super Bowl 2025 : quand les marques battent en retraite
Résister à Trump : « Don’t believe him ! »
Avec Trump, chaque jour apporte son lot de provocations, de mesures extrêmes ou de déclarations sidérantes. Rien d’improvisé dans cette avalanche : elle répond à une stratégie bien rodée, théorisée par Steve Bannon dans une interview de 2019 :
« Les médias sont l’opposition, et comme ils sont stupides et paresseux, ils ne peuvent s’intéresser qu’à une chose à la fois. Tout ce que nous avons à faire, c’est noyer la zone. Chaque jour, nous devons leur balancer trois choses. Ils en mordront une et nous pourrons faire nos affaires. Bang, bang, bang, ils ne s’en remettront jamais. »
L’objectif est simple : saturer l’espace médiatique, brouiller les repères, créer du chaos pour faire diversion. Une méthode qui rappelle ce que Naomi Klein analysait dès 2007 dans La Stratégie du choc : utiliser la sidération pour neutraliser le débat collectif, affaiblir les contre-pouvoirs : scientifiques, journalistes, institutions, et ainsi faire passer des mesures impopulaires dans le tumulte.
Dans une vidéo du New York Times, le journaliste Ezra Klein explique qu’au-delà de vouloir gouverner seul et dans le chaos, Donald Trump cherche à instiller une idée encore plus insidieuse. Il détiendrait un pouvoir supérieur à tous les présidents américains avant lui et qu’il serait alors vain de lui résister.
Ezra Klein nous invite à ne pas le croire, comme acte de résistance, un refus de se soumettre à sa volonté, présentée comme inévitable. Parce que ses décrets peuvent être stoppés dans les tribunaux. Le Groenland peut refuser d’être américain. On peut quitter le bureau oval refusant le récit imposé. Refuser que Gaza devienne une Riviera…
La vérité de Trump n’est pas performative, nous pouvons résister ! Don’t believe him !

Aux États-Unis, la science entre en résistance
Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump mène une offensive contre la science. Climatosceptique, persuadé que la lutte contre le réchauffement climatique freine la prospérité des États-Unis, Trump veut casser le thermomètre pour ne plus voir la fièvre.
En ligne de mire : les chercheurs et les agences fédérales. La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), pilier de la recherche environnementale, en paie un lourd tribut : personnel réduit à son plus bas niveau historique, bâtiments menacés de fermeture, son centre de prévision météorologique a dû suspendre ses activités, faute de moyens.
Sans les données de l’agence américaine, c’est toute la planète qui perd un accès précieux aux recherches sur le climat, les océans, les catastrophes naturelles et les prévisions météo, dont certaines activités économiques, comme l’agriculture, l’assurance ou la pêche, qui dépendent étroitement des conditions climatiques. Le Washington Post révèle que plusieurs représentants de ces industries ont interpellé l’administration Trump pour demander le maintien des activités de l’agence, rappelant que « peut-être qu’aucune autre entité fédérale ne facilite une plus grande activité économique et commerciale que la NOAA et ses sources de données ».
Face à cette asphyxie organisée de la science américaine, la résistance commence à s’organiser. Le mouvement Stand Up For Science mobilise chercheurs, enseignants et citoyens pour défendre la liberté académique. Depuis mars, des manifestations aux Etats-Unis et aussi en Europe se sont multipliées pour dénoncer les atteintes répétées à la science et exiger la réhabilitation des institutions scientifiques.
Et cette mobilisation commence à porter ses fruits. Comme le rapporte Le Monde, des décisions de justice ont invalidé plusieurs vagues de licenciements dans les agences fédérales. Résultat : près de 25 000 agents en période d’essai ont été réintégrés dans 18 agences, dont de nombreux chercheurs.
L’union sacrée des Canadiens face à Trump

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump n’a cessé de cibler le Canada. Entre les provocations symboliques, invitant le Canada à devenir le 51ᵉ état des États-Unis et les attaques économiques avec l’augmentation des droits de douane, le ton est donné.
Pour un pays dont 80 % des exportations traversent sa frontière, la menace est sérieuse.
Mais cette offensive a produit un effet inattendu : elle a réveillé un puissant sentiment d’unité nationale. Politiques, syndicats, entreprises et citoyens se retrouvent soudain du même côté : celui de la souveraineté canadienne. « Le président Trump a accompli une chose : il a unifié les Canadiens plus que jamais auparavant ! », observe l’ancien premier ministre Jean Chrétien.
Cette mobilisation dépasse le champ politique. Elle s’incarne désormais jusque dans les rayons des supermarchés. Les marques canadiennes se sont emparées du mouvement pour inciter les Canadien·ne·s à consommer national. À commencer par Aliments Aylmer, qui a frappé fort avec sa publicité « LA soupe canadienne » : on y voit des Canadiens savourant leur soupe, jusqu’à l’interruption d’un flash info annonçant… les nouvelles taxes douanières américaines. « Certaines soupes goûtent les tarifs. » Le message est clair : acheter canadien, c’est refuser de se faire avaler.

Et ce message trouve un écho réel dans les choix de consommation des Canadien·ne·s. Dans Le Monde, on apprend que faire ses courses au Canada est en train de devenir un acte de résistance. Les enseignes multiplient les initiatives pour mettre en valeur les produits canadiens, et les consommateurs suivent : 70 % d’entre eux affirment avoir augmenté leurs achats de produits canadiens depuis le début de la crise.
Et comme choisir, c’est aussi renoncer, certains produits américains en paient aujourd’hui le prix. Coucou Tesla, dont les ventes ne cessent de s’effondrer. Quand une marque s’adresse à une clientèle progressiste, mais que son dirigeant fait un salut nazi et soutient l’extrême droite européenne… il y a, disons, un léger problème d’alignement. Si Tesla cristallise ce phénomène, il s’étend bien au-delà. En Scandinavie, Le Courrier International rapporte une multiplication de pages Facebook appelant au boycott des produits venus des États-Unis.

Face au backlash conservateur : les entreprises entre rétropédalage et résistance
Dans notre dernière newsletter, nous évoquions le revirement de certaines entreprises américaines sur leurs politiques de Diversité, Équité et Inclusion (DEI). Avec la réélection de Donald Trump, cette tendance s’accélère et touche des entreprises jusqu’à présent engagées sur ces sujets.
Du militantisme au silence
Le parallèle avec 2017 et la première élection de Trump est marquant : nombre d’acteurs économiques s’étaient alors exprimés pour défendre des valeurs en lien avec la transition écologique et sociale. Le militantisme affiché d’hier a aujourd’hui laissé place à une posture plus prudente, voire à un changement de cap assumé.
Tous les secteurs sont concernés. La tech (Meta, Amazon, Google…), la finance (Goldman Sachs, BlackRock, Bank of America), le divertissement (Netflix, Disney), le conseil (KPMG, Deloitte), la grande consommation (McDonald’s, Walmart, Target)… Nombreuses sont les entreprises qui renoncent à leurs objectifs de représentation des minorités. Forbes a même dressé une liste d’entreprises ayant supprimé leurs programmes DEI, et elle ne cesse de s’allonger.
Et en France ?
Ici, le contexte est bien sûr différent. On n’observe pas (encore) de recul sur les politiques de diversité. Au contraire, on peut souligner l’initiative de Sodexo, Accor et Orange, qui ont impulsé début 2025 le mouvement « Elan », destiné à rendre les entreprises plus inclusives. Mais pour combien de temps ? Une lettre de l’ambassade américaine à Paris, adressée fin mars à de nombreux groupes français, a créé la stupeur en exigeant que « tous les contractants du département d’Etat doivent certifier qu’ils ne conduisent pas de programmes de promotion de DEI ». Pour l’instant, aucune entreprise n’a communiqué officiellement sur cette missive, ni annoncé l’abandon de ses engagements.
Pendant que d’autres résistent
Aux États-Unis, quelques-uns restent droit dans leurs bottes : le milliardaire Michael Bloomberg s’est engagé à financer une partie des contributions nécessaires à la lutte contre le changement climatique. Le cabinet McKinsey a confirmé sa politique de « méritocratie diversifiée ». Patagonia a pris position contre les projets de privatisation de terres publiques aux États-Unis. D’autres, comme Ben & Jerry’s, Apple ou encore Costco maintiennent leurs engagements.

Revirement idéologique ou simple pragmatisme ?
On peut supposer plusieurs explications à ce revirement : crainte de représailles, opportunisme, ou tout simplement pragmatisme économique ? Ce backlash aura au moins le mérite de mettre la lumière sur la sincérité des engagements pris par le passé. Au final, les choix des dirigeants et des conseils d’administration sont-ils guidés par des convictions profondes ou par une logique purement financière ? Comme le disait le publicitaire Bill Bernbach : « It’s not a principle until it costs you money ».
Sous pression, l’ADEME choisit la transparence et l’action
Ces derniers mois, sous une certaine influence des Etats-Unis, les agences d’Etat françaises ont elles aussi été mises sous le feu des projecteurs. ADEME, Office Français de la Biodiversité, Agence Bio, et bien d’autres ont été sommées de justifier de leur pertinence. Elles sont scrutées, critiquées, et menacées de suppression, de fusion, de réduction de moyens… Mais affaiblir ces structures, c’est fragiliser notre capacité à affronter des défis majeurs : effondrement de la biodiversité, crise climatique, adaptation agricole, gestion des ressource, etc.
Face aux critiques, l’ADEME agit pour ne pas subir ces attaques sans riposter et met en œuvre une stratégie de communication rodée pour reprendre la main. Les maîtres-mots ? Montrer, prouver, convaincre. Sur le terrain, au contact des PME, des élus, des associations, elle défend son action par les faits, relayés dans une campagne presse locale et nationale.
On l’accuse de freiner l’économie ? Elle démontre l’inverse à travers des reportages sur Ici (ex-France Bleu), Ouest France, Challenges : investir dans la transition, c’est créer de l’emploi, stimuler l’innovation et réduire les coûts.

On la dépeint comme une administration lointaine et bureaucratique ? L’ADEME s’assure de donner la parole à ses équipes, rappelant que derrière la structure, ce sont des centaines de professionnels engagés qui accompagnent des milliers d’entreprises, de collectivités, d’associations.
Et face aux attaques politiques, son président Sylvain Waserman incarne la riposte. Lettres ouvertes, photos sur le terrain, vidéos spontanées sur LinkedIn enregistrées très simplement au téléphone dans son bureau, il joue la transparence et l’accessibilité, loin des discours technocratiques.
Plutôt que de s’épuiser en polémiques, l’ADEME mise sur l’action. Pendant que les débats enflamment les plateaux télé, elle prouve son impact sur le terrain. Une piste de résistance qui nous inspire face à la trumpisation des débats dont on parle plus haut : moins de blabla, plus de résultats !
Super Bowl 2025 : quand les marques battent en retraite
Le Super Bowl 2025 a livré son lot de publicités spectaculaires, attendues non seulement par les Américains, mais aussi par les créatifs et publicitaires du monde entier. Alors qu’il y a quelques années, on constatait une vague croissante de publicités centrées sur les questions de diversité et d’inclusion, l’édition 2025 témoigne d’un net recul sur ces sujets.
Ce phénomène s’inscrit dans le contexte politique qu’on connait, où les initiatives DEI (Diversité, Équité, Inclusion) font l’objet d’attaques frontales. Les grandes marques, sensibles aux vents politiques, semblent ajuster leur communication en conséquence.
Un changement de cap manifeste
À l’exception de la campagne Nike « So Win », saluée pour sa mise en avant d’athlètes féminines, peu de marques ont pris le risque de défendre des valeurs inclusives ou d’aborder des sujets sociétaux clivants.
Le cas de Bud Light est emblématique de cette tendance. Après la tempête médiatique provoquée par son partenariat avec l’influenceuse transgenre Dylan Mulvaney en 2023, la marque a choisi de revenir sur un terrain plus sûr avec son spot « Big Men on the Cul-de-Sac », privilégiant des codes plus traditionnels, masculins et consensuels.
Plus surprenant encore, Carl’s Jr. a ressuscité ses publicités « Bikini & Burger » que beaucoup pensaient enterrées à l’ère post-#MeToo marquant un virage vers des communications moins progressistes.
L’analyse des publicités publiée par The Drum met en évidence des chiffres révélateurs. Si la représentation féminine a augmenté dans les publicités du Super Bowl (44% contre 34% en 2023), cette visibilité mérite d’être nuancée. Une femme objectifiée dans une publicité contribue-t-elle vraiment à l’avancée de la cause féminine ?
Plus inquiétant encore, la représentation des personnes racisées a chuté de manière drastique, avec une baisse de 41 % par rapport à 2023 (passant de 29 % à 17 %).

Un Super Bowl miroir de la société américaine ?
Ces chiffres traduisent un changement profond dans la visibilité accordée à certains groupes sur la plus grande scène publicitaire de l’année.
Les spots du Super Bowl ont toujours constitué un baromètre précieux des valeurs dominantes et des tensions traversant la société américaine. L’édition 2025 ne fait pas exception, reflétant un pays politiquement divisé où les avancées en matière de diversité et d’inclusion semblent fragilisées.
Le recul observé révèle la nature cyclique des progrès sociaux et souligne la fragilité de nos avancées en matière de représentation. Les marques semblent avoir choisi la voie de la prudence, voire du repli. Une question demeure : s’agit-il d’un phénomène passager lié au contexte politique immédiat ou d’une tendance plus profonde qui marquerait durablement les stratégies de communication des grandes marques ?